Cet article est une traduction de celui-ci : Hunter-gatherers live in relative peace écrit par Jason Godesky et publié sur le site Rewild.com le 2 mai 2016.
Alors que certains chasseurs-cueilleurs se battent et tuent, la plupart vivent avec beaucoup moins de violence que le monde moderne. Les guerres n’ont de sens (et n’apparaissent dans les archives archéologiques) que lorsque votre survie dépend du contrôle d’un terrain spécifique, comme un jardin ou un champ. Sans cela, les chasseurs-cueilleurs préfèrent généralement éviter les conflits plutôt que de risquer leur vie au combat.

In Memoriam de Lord Alfred Tennyson décrit l’humanité : “Who trusted God was love indeed / And love Creation’s final law / Tho’ Nature, red in tooth and claw / With ravine, shriek’d against his creed.” Ce verset célèbre reflète la crise théologique que la théorie de l’évolution a présentée. La théorie de Darwin semblait fondée sur la supposition d’un monde naturel violent où seuls les plus forts pourraient survivre.
Depuis l’époque de Darwin et de Lord Tennyson, cependant, les chercheurs ont composé un vaste corpus de littérature sur les expositions de menaces animales. Se battre entraîne des coûts et des risques énormes pour tout animal, de sorte qu’un animal qui se montre trop désireux de se battre perdra. Plutôt que de rendre la nature « rouge de dents et de griffes », l’évolution a le plus souvent choisi une aversion significative pour les conflits. À moins qu’un animal n’ait une indication certaine qu’il gagnera sans blessure, ou que la question des ressources est tellement significative que risquer des blessures ou la mort a du sens, les animaux essaient d’éviter de se battre. Les démonstrations de menaces jouent un rôle clé à cet égard, permettant aux animaux de résoudre les conflits sans recourir à la violence réelle. Cela ne fonctionne pas toujours, bien sûr. Parfois, des combats ont encore lieu. L’évolution ne favorise pas plus « les forts », cependant, qu’il favorise ceux qui sont assez sages pour choisir leurs batailles et éviter un combat chaque fois qu’ils le peuvent.

Cette idée persistante de la violence inhérente au monde naturel se combine facilement avec le mythe européen du « sauvage » si souvent projeté sur les peuples traditionnels (Jahoda, 1998) pour faire paraître si évident que sans civilisation, les humains doivent vivre constamment dans la violence, la guerre et les conflits, et que cela ne nécessite pratiquement aucune recherche, données ou validation. Au vingtième siècle, cependant, les anthropologues ont fait sensation en examinant les sociétés traditionnelles et en trouvant beaucoup d’entre elles moins violentes que prévu, allant même jusqu’à appeler certaines d’entre elles « sans guerre ».
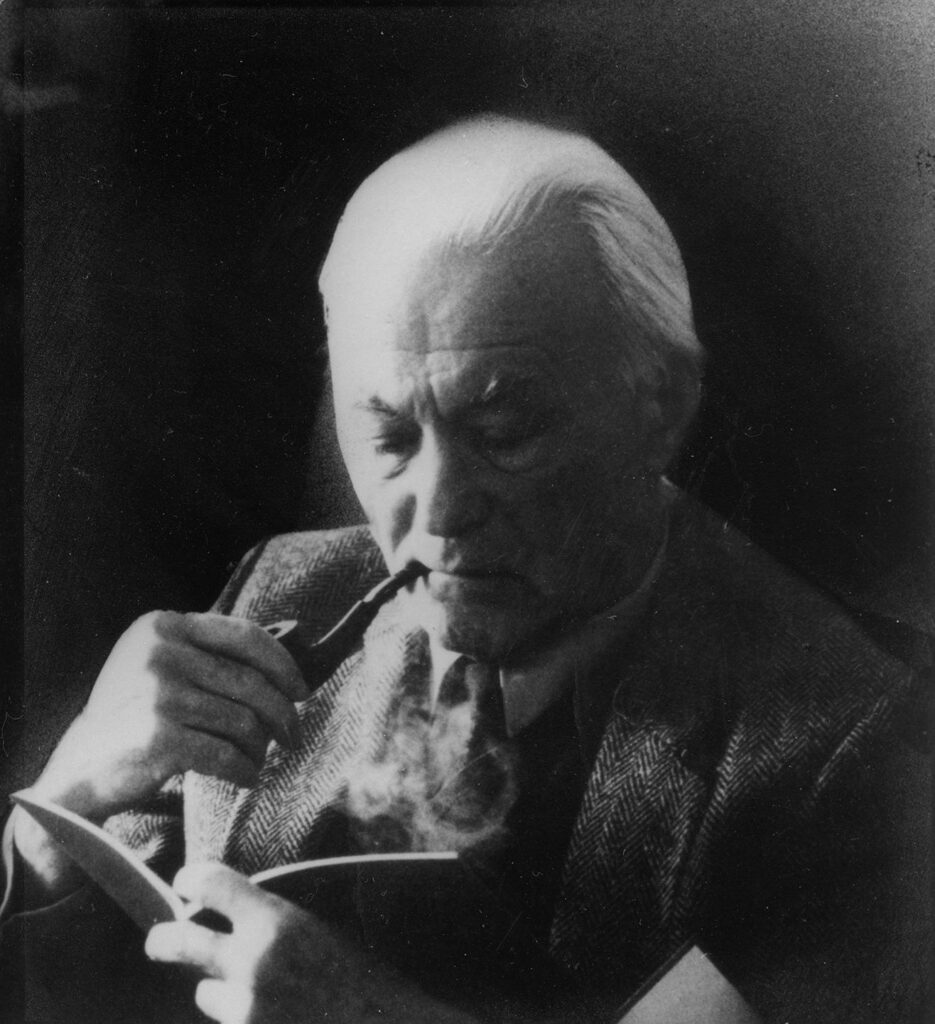
En règle générale, les anthropologues ont constaté que les chasseurs-cueilleurs semblaient très opposés aux conflits. Lorsqu’ils étaient menacés par un groupe voisin, les chasseurs-cueilleurs se déplaçaient simplement vers une autre partie de leur territoire. Quand la menace s’en allait, ils revenaient. Ils avaient peu de raisons de se battre et ne se battaient donc généralement pas très souvent. En revanche, les sociétés qui dépendent de la culture vivent dans des établissements fixes. Ces sociétés partent beaucoup plus souvent en guerre, car elles doivent défendre des points fixes comme des villages, des villes et des champs, et ne peuvent pas simplement s’en éloigner comme le peuvent les chasseurs-cueilleurs (Kelly, 2000).
Les preuves archéologiques semblent étayer cette idée, ne montrant aucune preuve de conflit violent jusqu’à il y a 10 000 ans, bien avant le néolithique, lorsque les sociétés horticoles et agricoles ont commencé à émerger (Ferguson, 2013). Le plus ancien art rupestre représentant une bataille provient de la Terre d’Arnhem, datant d’il y a 10 000 ans (Taçon & Chippindale, 1994). Nous trouvons également certaines des premières preuves squelettiques d’humains tués violemment par d’autres humains à la même époque (Haas & Piscitelli, 2013).
Après quelques décennies de preuves croissantes, un contrecoup a commencé à se développer. Alors que des écrivains ultérieurs comme Steven Pinker et Jared Diamond ont attiré plus d’attention, ils se sont tous fortement appuyés sur le travail de Lawrence Keeley. Keeley a souligné que si les conflits observés parmi ce qu’il a appelé les sociétés « primitives » peuvent entraîner peu de victimes, ces sociétés ont de très petites populations, nous devons donc les considérer non pas comme des nombres absolus mais comme des pourcentages. De ce point de vue, a fait valoir Keeley, même quelques victimes peuvent signifier un pourcentage plus élevé de la population tuée pendant la guerre que les habitants des pays WEIRD (occidentaux, éduqués, industrialisés, riches et démocratiques) tués pendant la Seconde Guerre mondiale. (Keeley, 1996)

L’argument de Keeley attire notre attention sur une question délicate : comment faire la distinction entre une guerre et un homicide ? Margaret Mead fait la distinction entre la violence individuelle et la violence de groupe chez les Inuits du Groenland. Elle a noté qu’on pouvait difficilement les considérer comme un « peuple doux », car ils se livraient à « des bagarres, des vols de femmes, des meurtres, du cannibalisme » et d’autres actes de violence, souvent provoqués par la peur de la famine. Elle a noté que les Inuits ont « la personnalité prompte à la guerre, les circonstances nécessaires pour pousser les hommes au désespoir sont présentes, mais il n’y a pas de guerre ». (1990) De même, Raymond Kelly considérait la guerre comme une composante sociale vitale. En temps de guerre, des individus tuent pour nuire à un autre groupe en tant que groupe, plutôt qu’aux individus de ce groupe, et ils agissent en tant qu’agents de leur propre groupe. Les individus doivent, bien entendu, commettre les actes de violence individuels qui composent une guerre, mais sans ce sentiment d’agir au nom d’un groupe et contre un groupe différent, cette violence n’a pas le contexte social d’une guerre (Kelly, 2000).
Kelly et Keeley citent tous les deux le Gebusi comme exemple pour prouver leur point de vue. Selon Keeley, “l’armée américaine aurait dû tuer la quasi-totalité de la population du Sud-Vietnam au cours de son implication de neuf ans là-bas, en plus de son taux d’homicides internes, pour égaler le taux d’homicides des Gebusi”. (Keeley, 1996) Kelly, cependant, souligne que dans la plupart des cas d’homicide de Gebusi auxquels Keeley fait référence, Gebusi a tué un prétendu sorcier, brouillant les lignes non seulement entre l’homicide et la guerre, mais l’homicide et ce qui, dans le contexte d’un État, tomberait au titre de la peine capitale. Kelly soutient que nous ne pouvons pas appeler une situation comme celle-ci « guerre ». Alors que le ou les tueurs peuvent se considérer comme les agents d’un groupe, ils agissent contre un individu en tant qu’individu (Kelly, 2000).
Keeley et ses successeurs reviennent encore et encore dans la même petite poignée de sociétés. En apparence, les données semblent indéniables, mais si l’on prend le temps d’examiner ces sociétés individuellement, une autre histoire se dessine.

Les Yanomami
Quelque 35 000 Yanomami vivent aujourd’hui dans 200 à 250 villages de la forêt amazonienne, à cheval sur la frontière entre le Venezuela et le Brésil. Ils dépendent de l’horticulture sur brûlis pour faire pousser des bananes, mais ils chassent aussi, pêchent et cueillent des fruits dans la forêt. Ils vivent dans des villages communaux de 50 à 400 individus appelés shabonos.
Les Yanomami sont devenus le sujet de nombreuses recherches et discussions ethnographiques en grande partie à cause du travail de terrain de Napoléon Chagnon au milieu des années 1960 et à la fin des années 1990. Chagnon disait que les Yanomami existaient « dans un état de guerre chronique » (Chagnon, 1968). Son argument selon lequel les hommes Yanomami les plus guerriers et les plus violents avaient plus d’enfants est devenu influent en sociobiologie, amenant certaines personnes comme Richard Dawkins et Steven Pinker à le louer comme un scientifique brillant et intrépide.

Le travail de Chagnon reposait sur la collecte de généalogies, mais les Yanomami n’utilisent pas le genre d’identités fixes nécessaires à un tel modèle occidental. Ils emploient de nombreux noms différents dans des contextes différents et peuvent facilement se débarrasser des anciens noms et en acquérir de nouveaux. Dans ses mémoires, Chagnon avoue avoir entrepris « la tâche délicate d’identifier tout le monde par son nom et de les numéroter à l’encre indélébile pour s’assurer que tout le monde n’avait qu’un seul nom et identité ».
Pire encore, les Yanomami considèrent que prononcer le nom de quelqu’un en leur présence est une grave insulte. Ils considèrent également qu’il est primordial d’exclure complètement les morts de la société. Ceci, bien sûr, rendit extrêmement difficile pour Chagnon la compilation de ses généalogies. Les Yanomami se crient les noms les uns des autres lorsqu’ils s’alignent pour combattre précisément pour provoquer leurs ennemis. Ainsi, pour compiler les généalogies d’un village, il rendrait visite à ses ennemis. Il confirmerait ces noms en retournant au village pour commencer à les réciter. Si cela enrageait ses hôtes, il savait qu’il avait les bons noms.
Chagnon a également cajolé et soudoyé les Yanomami pour obtenir des noms en montant les villageois les uns contre les autres ou en les coinçant seuls. Il comptait beaucoup sur la distribution de petites fortunes en outils en acier, notamment des haches et des machettes, pour payer des informateurs (Sahlins, 2000). En fin de compte, Chagnon a recueilli 10 000 noms, dont les noms de 7 000 Yanomami décédés.
Chagnon comprit que ses pots-de-vin créaient de l’animosité. « La distribution de biens commerciaux mettait toujours en colère les gens qui ne recevaient pas ce qu’ils voulaient, et il était inutile d’essayer de travailler plus longtemps dans le village. » (Chagnon, 1968) Au-delà de cette simple envie, cependant, l’approche de Chagnon a provoqué une énorme hostilité et colère. Les Yanomami le méprisaient tellement que beaucoup partiraient en guerre avec n’importe quel village qui l’accueillerait. (Sahlins, 2000) eux-mêmes avec. Bref, tout ce que Chagnon a fait encourage et incite à la guerre, soulevant la question : devons-nous considérer le conflit que Chagnon a observé comme la preuve d’un « état de guerre chronique », ou le résultat sans surprise des propres actions de Chagnon ?
Les affirmations de Chagnon ont suscité un grand intérêt pour les Yanomami, à la fois parmi ceux qui les considéraient comme une preuve de la nature sombre et violente de l’humanité, et ceux qui contestaient les méthodes et les conclusions de Chagnon. Sans surprise, d’autres anthropologues, s’appuyant sur des méthodes plus éthiques et efficaces, ont eu du mal à reproduire les résultats de Chagnon.
Brian Ferguson a écrit que « toutes les guerres yanomami que nous connaissons se déroulent dans ce que Neil Whitehead et moi-même appelons une « zone tribale », une vaste zone échappant au contrôle administratif de l’État, habitée par des personnes non étatiques qui doivent réagir aux effets à grande échelle. de la présence de l’État. (1995) Là où Chagnon considérait les Yanomami comme un exemple de groupe non affecté par les Occidentaux, Ferguson a retracé les causes profondes du conflit Yanomami à l’expansion occidentale. Cela n’impliquait pas toujours directement un conflit avec les puissances coloniales. En fait, il s’agissait le plus souvent de conflits avec d’autres groupes tribaux déplacés, en fin de compte, par les Occidentaux, créant un effet domino de guerres et de conflits dans toute la région qui s’étendait bien au-delà des zones réellement saisies par les colons.

Les Waorani
Comme les Yanomami, les Waorani s’appuient sur une combinaison d’horticulture, de chasse et de cueillette pour gagner leur vie dans la forêt amazonienne. Keeley et ceux qui l’ont suivi ont cité une étude sur les histoires de famille Waorani qui estimait qu’avant le contact européen, jusqu’à 54 % de tous les décès d’hommes étaient dus à un homicide (Beckerman et al, 2009).
Les Waorani eux-mêmes comprennent cela comme une période exceptionnellement sombre de leur histoire, la faisant remonter à une rupture des relations claniques dix générations auparavant. Avant cela, on dit que les grands rassemblements réunissaient de temps en temps des clans éloignés. Lorsque cela s’est effondré, les moyens de communication entre les clans ont fait de même. Les conflits se sont multipliés et ont finalement atteint un état vraiment terrible. Les Waorani ne considèrent pas cela comme un état de fait normal, mais plus proche de ce que quelqu’un d’un pays WEIRD considérerait comme un scénario post-apocalyptique.
Les Waorani fournissent également un contre-exemple quantitatif à l’affirmation de Chagnon selon laquelle la violence fournit un avantage évolutif. Les chercheurs ont découvert chez les Waorani que les hommes les plus violents n’avaient pas le plus d’enfants ; au lieu de cela, les hommes qui ont adopté une approche plus modérée de la vengeance et de la violence avaient de meilleures chances de succès reproductif (Beckerman et al, 2009). Les auteurs ont suggéré que le laps de temps entre les actes et la vengeance pourrait expliquer la différence. D’un autre côté, Chagnon n’a pas compris que les Yanomami « accordent le statut rituel de tueur d’hommes aux sorciers qui pratiquent la magie de la mort et aux guerriers qui tirent des flèches sur des ennemis déjà blessés ou morts ». En bref, le calcul bâclé de Chagnon pourrait bien avoir inclus bon nombre d’individus les moins violents. Certes, les résultats des Waorani confirment ce que nous voyons chez les animaux autres qu’humains : même s’il ne vaut pas la peine de s’engager exactement dans le pacifisme, agir de manière trop agressive ne fera que vous plonger dans une tombe prématurée.

Le Shuar
Comme les Yanomami et les Waorani, les Shuar s’appuient sur une combinaison d’horticulture, de chasse et de cueillette pour gagner leur vie dans la forêt amazonienne. Ils vivent près des sources du fleuve Marañon et de ses affluents dans le nord du Pérou et l’est de l’Équateur. Ceux qui citent les Shuar comme des exemples de violence parmi les sociétés « primitives » utilisent souvent le terme « Jívaro », devenu péjoratif en Équateur, signifiant « sauvage ». Bien que « Shuar » désigne également un groupe Jívaroan en particulier, la plupart d’entre eux utilisent une variante du terme pour eux-mêmes.
En 1527, les Shuar ont résisté à une invasion inca, mais ils sont tombés sous la domination espagnole peu de temps après. En 1599, ils se sont rebellés contre la domination espagnole. Les Espagnols ont écrit sur leur violence et leur férocité, semant les graines de leur réputation de peuple guerrier.

Après leur expérience avec les Espagnols, les Shuar ont résisté à tout contact ultérieur avec le monde occidental jusqu’au XIXe siècle. Les euro-américains découvrent alors leur pratique de créer des tsantsa , ou têtes réduites. Les Shuar considèrent cela comme un moyen de contenir le muisak de cette personne , un esprit vengeur qui autrement s’échapperait et chercherait continuellement à se venger du tueur. Les Euro-Américains ont trouvé cette pratique exotique et fascinante, et ont offert beaucoup d’argent aux Shuar en difficulté pour eux, alors les Shuar ont attaqué leurs ennemis traditionnels, comme les Achuar, pour collecter plus de tsantsa à vendre. Ces meurtres ont naturellement conduit à des actes de vengeance et ont finalement créé des cycles de guerre (Steel, 1999).
Plus récemment, Stephen Corry a écrit sur son expérience avec un autre groupe jivaroan dans les années 1970, les Aguaruna. Il a noté que les missionnaires et les compagnies pétrolières avaient poussé les Aguaruna dans des territoires de plus en plus petits le long du fleuve. La proximité forcée a exacerbé les anciennes inimitiés, qui ont dégénéré en conflits et en raids meurtriers (2013).

L’Enga
Les Enga vivent en Nouvelle-Guinée en tant qu’horticulteurs qui dépendent fortement des porcs et des patates douces, une culture introduite sur leur île par les Portugais il y a 350 ans. L’introduction de la patate douce a déclenché des compétitions féroces pour le statut, la richesse et la terre, donnant finalement lieu à l’un des systèmes les plus étendus de rituels, de guerre et d’échanges cérémoniels connus dans une société pré-étatique, impliquant plus de 40 000 personnes (Dressler , 2010).

Les Enga reconnaissent de nombreuses causes immédiates de querelles, de guerres et d’autres conflits, y compris le viol et le vol, mais la cause ultime se résume généralement à la compétition pour la terre pour cultiver des patates douces. « Les Enga eux-mêmes reconnaissent que les guerres sont causées par la concurrence pour les terres agricoles, en particulier la quantité limitée de terres de choix utilisées pour la culture permanente et intensive de patates douces. Plus de la moitié de toutes les guerres d’Enga sont explicitement reconnues comme étant terrestres. (Johnson, 2000)
Entre 1990 et 2005, l’Enga a connu une flambée de violence majeure, avec plus de 250 guerres tribales livrées en quinze ans. L’influence occidentale a conduit à la rupture de la hiérarchie traditionnelle basée sur l’âge, tout en fournissant aux jeunes en colère des armes suffisamment puissantes pour leur permettre de prendre le contrôle. À partir de 2004, cependant, « les Enga se sont inspirés de leurs techniques culturelles coutumières pour résoudre les conflits par des anciens, résolvant les problèmes par la médiation et la justice réparatrice plutôt que par des conflits armés engageant des mercenaires armés de mitrailleuses, ou« rambos ». Alors que la population se lassait de la guerre et se tournait vers l’autorité coutumière, la violence s’est apaisée. » (Gordon, 2012)

Le Dani
Les Dani forment l’une des tribus les plus peuplées des hauts plateaux du centre de l’ouest de la Nouvelle-Guinée. Comme les Enga, ils vivent comme des horticulteurs, se nourrissant de porcs et de patates douces. Leur vie politique tourne autour des « grands hommes », des individus qui accumulent du capital social en échangeant des faveurs et en organisant de grands partis. Chez les Dani, le statut d’un grand homme dépend généralement du nombre de porcs qu’il peut abattre lors d’un festin, ce qui nécessite généralement d’encaisser un certain nombre de faveurs à la fois, car personne ne peut augmenter le nombre de porcs requis. Les sociétés de big man ont généralement une réputation d’instabilité, car les concurrents essaient constamment de prendre la place du big man actuel en organisant une plus grande fête ou en collectant plus de capital social.
Les Dani pratiquent une forme de guerre rituelle à petite échelle qui met l’accent sur l’insulte ou la blessure des ennemis plutôt que sur la capture du territoire que certains ethnographes ont comparé au « hooliganisme du football ». Des critiques comme Keeley ont fait valoir que bien que les chiffres semblent faibles, en pourcentage de la population totale de Dani, les pertes occasionnelles subies dans ces guerres représentent un lourd tribut.
Cependant, comme l’a souligné Stephen Corry, les Dani vivent en Papouasie occidentale, une zone envahie et brutalement réprimée par l’Indonésie depuis les années 1960. Depuis lors, bien plus de Dani sont morts à cause de l’oppression indonésienne que dans les guerres tribales (Corry, 2013).

Le Gebusi
Les Gebusi de Papouasie-Nouvelle-Guinée dépendent à la fois de l’horticulture et de la chasse et de la cueillette, tout comme leurs voisins agressifs et peuplés à l’est, les Bedamini. Les deux groupes ont une longue histoire de conflit. Keeley cite Bruce Knauft, un ethnographe qui a beaucoup travaillé avec les Gebusi, qui a déclaré : “Seuls les cas les plus extrêmes d’abattage de masse moderne égaleraient ou dépasseraient le taux d’homicides Gebusi sur une période de plusieurs décennies.”
Bien sûr, Knauft n’a pas voulu dire n’importe quelle « période de plusieurs décennies » au hasard, mais une période très spécifique de changement culturel massif. Ces changements ont provoqué de plus grands raids entre les Gebusi et les Bedamini, mais les changements écologiques et sociaux ont également créé le genre d’incidents qu’ils attribuaient traditionnellement à la sorcellerie. Une grande partie du taux d’homicides des Gebusi provenait du meurtre de sorciers. Contrairement à de nombreuses autres cultures de Nouvelle-Guinée, les Gebusi ont officialisé le processus d’accusation d’un sorcier et ont mené une enquête pour enquêter sur l’accusation, soulevant une fois de plus la question de savoir comment distinguer la guerre, l’homicide et la peine capitale dans une telle société.
Après que Keeley ait écrit son livre, Knauft a publié une autre étude sur les Gebusi, notant comment la violence dans leur société a considérablement diminué, non pas à cause de l’intervention de l’État, mais en créant activement un mélange de modernité et de leurs propres traditions.
“Ces développements ont été initiés ainsi que médiatisés par les intentions et les décisions des Gebusi eux-mêmes ; non par des intrusions de coercition et de contrainte, mais plutôt par la propre volonté des Gebusi. C’est peut-être en effet l’absence relative de pression extérieure – la capacité des Gebusi à déterminer leur sort et leur avenir local selon leurs propres termes – qui leur a permis d’éviter des schémas de violence croissante qui sont communs sinon surdéterminés dans de nombreux pays sous-développés“. (Knauft, 2011)

Les Yolngu
Parmi les sociétés les plus souvent citées par Keeley et celles qui lui ont succédé, seuls les Yolngu – pour lesquels ils utilisent souvent le terme plus ancien, « Murngin » – vivent principalement de la chasse et de la cueillette. Les Yolngu vivent à Arnhem Land en Australie. Selon certaines estimations, jusqu’à 25 % des jeunes hommes sont morts violemment chez les Yolngu avant le contact avec les colons européens (Dyer, 2010). La plupart d’entre eux, cependant, ont pris la forme d’assassinats par vengeance (Kelsen, 2009), soulevant à nouveau la question de savoir comment séparer l’homicide, la guerre et la peine capitale dans le contexte d’une société traditionnelle. Le film Ten Canoes présente de nombreux acteurs Yolngu racontant une histoire traditionnelle Yolngu, où se déroule un tel cycle de vengeance.
Pour les Yolngu, le concept de réciprocité, si crucial pour tant de chasseurs-cueilleurs à travers le monde, s’étend à la vengeance. Ne pas tuer un tueur pourrait signifier une violation du principe de réciprocité, le principe organisateur central de la vie des Yolngu (Kelsen, 2009). Selon Nancy Williams, de nombreux Yolngu ont exprimé leur gratitude envers l’État pour avoir réussi à supprimer le cycle des meurtres par vengeance, mais ils ont également exprimé leur ambivalence quant à ce qu’il faut faire à la place.
« Comme l’a dit un chef de clan, Yolngu avait deux manières de traiter les personnes qui commettaient des infractions graves : leur parler et les tuer. Les vieillards avaient parlé et parlé, a dit le chef, mais ils ont dû faire face au problème de savoir comment punir les personnes qui ont commis des infractions pour lesquelles elles auraient dû être tuées. Il valait mieux ne pas tuer, dit-il, mais quelle punition prendrait sa place ? (William, 1987)
–
Vous avez peut-être déjà remarqué certains thèmes qui ressortent de ces exemples. Nous n’avons qu’un seul groupe qui dépend de la chasse et de la cueillette; les autres reposent tous dans une mesure ou une autre sur des lieux fixes, ce qui les empêche d’éviter simplement les conflits comme le feraient les chasseurs-cueilleurs. Trois viennent de Nouvelle-Guinée et trois d’Amazonie ; dans les deux cas, ce que les auteurs considèrent comme un contexte « naturel » et « primitif » a en fait une histoire longue et très pertinente. De nouvelles preuves archéologiques suggèrent que la forêt tropicale amazonienne moderne pourrait exister en tant que vestiges d’une société complexe que nous avons seulement commencé à découvrir (Heckenberger, 2009), qui mettrait en lumière des groupes amazoniens comme les Yanomami, les Waorani et les Shuar. , non pas en tant que « fossiles vivants » de notre passé « primitif », mais en tant que successeurs d’une civilisation anéantie par les maladies européennes. De même, vous pouvez noter que les trois groupes de Nouvelle-Guinée – les Enga, les Dani et les Gebusi – ont tous des sociétés construites autour de la culture de la patate douce, une culture introduite par les Portugais il y a quelques siècles à peine. Une grande partie de leur conflit tourne autour de la façon dont le contact européen a spécifiquement changé leur mode de vie.
Ces groupes mettent également en évidence le choix sur lequel Keeley et ceux qui lui ont succédé s’appuient pour défendre leur cause. Les exemples qu’ils citent encore et encore se distinguent comme certains des cas de violence les plus extrêmes dans les archives ethnographiques. La sélection va encore plus loin, car même dans ces sociétés, nous voyons les preuves sélectionnées venir de moments de conflit et de bouleversement. Ces groupes considèrent souvent ces périodes parmi les chapitres les plus sombres et les plus violents de leur histoire. Cela souligne que la plupart des sociétés deviennent vulnérables aux cycles de violence lorsque les traditions sur lesquelles elles s’appuient normalement pour coopérer, travailler ensemble et résoudre les différends s’effondrent. Ils pourraient examiner les mêmes sociétés, mais regarder d’autres périodes de leur histoire. Ils choisissent de ne pas le faire.

Alors, s’il s’agit des exemples les plus violents du dossier ethnographique, que trouve-t-on chez certains des chasseurs-cueilleurs le plus souvent cités et étudiés par les anthropologues ? Douglas Fry et Patrick Söderberg ont comparé les données ethnographiques de 21 sociétés de bandes de butineurs mobiles et ont découvert que « la plupart des incidents d’agression mortelle parmi [les sociétés de bandes de fourrageurs nomades] peuvent être classés comme des homicides, quelques autres comme des querelles et une minorité comme des guerres ». (2013) Elizabeth Thomas (2006) cite le travail de Richard Lee avec les Nyae Nyae Ju/’hoansi dans le Kalahari. Il a trouvé 22 homicides sur une période de 50 ans, ce qui donne un taux global d’homicides de 29,3 par million. Par comparaison, le taux d’homicides aux États-Unis s’élève à 42,01 pour un million, ce qui signifie que les Ju/’hoansi subissent 30,3 % de meurtres de moins que le citoyen américain moderne. Le taux d’homicides chez les Hadza passe de 0,66 par million à 4,0 par million si l’on inclut trois Hadza assassinés par le voisin Datoga. Les taux d’homicides enregistrés pour les Aché du Paraguay et les Hiwi de Colombie s’élèvent respectivement à 50,0 et 101,8 par million, mais ces chiffres peuvent nécessiter un peu de considération. Pour les Hiwi, ce nombre comprend toutes les morts violentes, y compris les meurtres par des Vénézuéliens, les suicides et les infanticides. Les meurtres commis par Hiwi ne représentent que 7 % de leur taux d’homicides ; Compte tenu de cela seul, le taux d’homicides chez Hiwi chuterait à 7,126 par million. De même, les chiffres Aché incluent le suicide, l’infanticide et les Aché assassinés par des étrangers. Robert Kelly conclut que « [c]es taux inférieurs sont similaires à ceux des Agta, Ju/’hoansi et Hazda, où la violence, sans compter l’infanticide, le suicide,ou des meurtres externes, représente 3 à 7 % des décès. (2013)
Ces taux d’homicides relativement bas ne découlent pas d’une tendance à la douceur ou à la non-violence dans la nature humaine, pas plus qu’aucun des groupes que nous avons considérés ne représente un « fossile vivant » du passé « vierge » de l’humanité. Chaque groupe a sa propre histoire ; prétendre qu’ils nous donnent un aperçu de la nature humaine nie leur réalisation remarquable. La paix relative dont ils jouissent ne nous montre pas l’état naturel de l’humanité, mais plutôt ce que l’humanité peut réaliser. Robert Kelly cite Colin Turnbull, qui « a enregistré une dispute notable tous les trois ou quatre jours parmi les Mbuti », ainsi que les travaux de Jean Briggs parmi les Inuits (2013). Dans les deux cas, les individus ont dû faire face à des conflits personnels, mais dans les deux cas, les sociétés ont mis l’accent sur les relations personnelles et le maintien de la paix. Elizabeth Thomas insiste sur le même point chez les bushmen du Kalahari :
« Oui, ils avaient de la violence en eux. Mais aussi longtemps que possible, ils l’ont freiné. Peu importe à quel point ils étaient provoqués, ils exprimaient rarement leur malaise et ne se l’exhalaient pas tant que leur ancienne culture les servait. Ce n’est pas pour rien qu’ils se sont appelés le Peuple Inoffensif, le Peuple Pur, quand le mal et les impuretés étaient la jalousie, la violence et la colère. (2013)
Pour parler de paix relative, cependant, il faut aussi considérer le point de comparaison : la violence dans les pays WEIRD. Alors que les États-Unis ont un taux d’homicides plus élevé que presque tous les groupes de chasseurs-cueilleurs, d’autres pays WEIRD ont des taux d’homicides beaucoup plus faibles. L’Allemagne, par exemple, se situe à 8,44 par million, bien inférieur au chiffre de Lee pour le Nyae Nyae Ju/’hoansi, mais toujours supérieur aux chiffres ajustés suggérés ci-dessus pour le Hiwi. Plusieurs autres pays WEIRD, dont la France (10,54 par million), le Royaume-Uni (11,68 par million) et le Canada (16,23 par million) occupent une position relative similaire.
Bien sûr, pour les pays WEIRD, ce nombre se réfère presque exclusivement aux membres de cette société assassinés par d’autres membres de cette société en tant qu’individus. La majorité du taux d’homicides parmi les chasseurs-cueilleurs ne provient souvent pas de chasseurs-cueilleurs qui s’entretuent, mais de leurs voisins éleveurs, horticulteurs et agriculteurs les pillant pour les esclaves et les chassant pour le sport. Les taux d’homicides dans les pays WEIRD, bien sûr, n’incluent rien de tel. Ils n’incluent pas les suicides, les morts de guerre ou les victimes d’exécutions sanctionnées par l’État. Les pays WEIRD n’ont pas subi beaucoup de morts de guerre au cours des dernières décennies, et même les États-Unis, connus parmi les pays WEIRD pour leur volonté d’exécuter des criminels, n’ont exécuté que 1 394 personnes en 38 ans (de 1976 à 2014), soit environ 41 personnes par an. L’observation de Keeley fonctionne ici à l’envers : tout comme la petite échelle des sociétés de chasseurs-cueilleurs signifie que même un seul décès a un impact énorme, l’échelle énorme des sociétés WEIRD signifie qu’une vie individuelle perd son sens. Exécuter en moyenne 41 personnes par an aux États-Unis a beaucoup moins d’impact que de savoir si le voisin Datoga assassine ou non trois Hadza.
Les sociétés civilisées ont une relation unique avec la violence que nous ne pouvons cependant pas comparer quantitativement à d’autres sociétés. Max Weber considérait qu’un « monopole de l’usage légitime de la force physique » faisait partie de la définition d’un État. En théorie, cela réduit la violence, même si, comme nous l’avons vu, les preuves semblent au mieux compliquées. En retour, elle exige un nouveau rapport à la violence. La plupart d’entre nous n’ont pas à commettre ou à se préparer personnellement à la violence, comme pourraient le faire les chasseurs-cueilleurs ; au lieu de cela, nous pouvons compter sur une classe de tueurs professionnels qui commettent des violences en notre nom. Dans les temps anciens, cela signifiait une armée, mais au cours des siècles plus récents, elle s’est élargie pour inclure la police. Un tel arrangement nécessite-t-il une occurrence régulière de conflit pour l’occuper ? Au cours des 3 400 dernières années d’histoire enregistrée, seulement 268 – 8 % de ce temps – se sont déroulés sans guerre (Hedges, 2003).
Nous ne pouvons pas quantifier l’effet de cette situation. Comme indiqué précédemment, la guerre a une composante sociale vitale, opposant une société à une autre, de sorte que cet état de guerre quasi permanente a un effet non seulement sur la petite partie de la société qui y est activement engagée, mais sur l’ensemble de la société.
Comment quantifier l’effet de la violence que le monopole de l’État insère dans chaque interaction ? Payer des impôts, respecter la limitation de vitesse et obéir à la loi se produisent tous sous la menace de la violence. On n’y pense pas souvent consciemment en ces termes, mais il reste là en arrière-plan, inavoué. Même les peines intermédiaires – les amendes, les contraventions, les convocations et les assignations à comparaître – ont leur force en raison de la menace qui les soutient que si vous ne vous conformez pas, une classe de tueurs professionnels s’intensifiera pour vous traquer, vous kidnapper et vous emprisonner, ou même vous tuer si vous résistez. Comment quantifier la relation entre la violence et la population emprisonnée des pays WEIRD, comme les États-Unis avec le taux d’incarcération documenté le plus élevé au monde à 754 pour 100 000 ?

Les chasseurs-cueilleurs n’ont aucune classe de tueurs professionnels à qui ils peuvent remettre leur violence. S’ils veulent que des violences soient commises, ils doivent les commettre eux-mêmes. Cette immédiateté aide à les garder conscients de l’importance d’éviter la violence. Dans les sociétés civilisées, un monopole sur la violence aide à définir l’État, transformant la violence de quelque chose qui arrive en quelque chose qui imprègne chaque facette de la vie.
Des auteurs comme Lawrence Keeley, Jared Diamond et Steven Pinker voudraient nous faire croire que cette transformation a fait du monde un endroit moins violent – essentiellement, qu’elle a eu l’effet promis. Ils s’appuient sur des preuves quantitatives qui semblent très claires et convaincantes à première vue, mais lorsque nous regardons plus profondément, nous pouvons voir comment ils ont sélectionné les données, passé sous silence les mises en garde importantes et finalement obscurci plus qu’ils n’en ont révélé. Les complexités rendent une comparaison directe difficile, et même si chaque mesure que nous utilisons sert à masquer la violence dans les sociétés civilisées et à la souligner parmi les chasseurs-cueilleurs, nous constatons toujours que les mesures quantifiables de la violence parmi les chasseurs-cueilleurs se comparent favorablement avec les pays WEIRD les plus sûrs aujourd’hui.
Les chasseurs-cueilleurs vivent dans une paix relative parce qu’ils ont créé des sociétés qui mettent l’accent sur l’importance des relations et de la résolution non violente, et non parce que la nature humaine nous rend essentiellement doux ou belliqueux. Comme Margaret Mead l’a dit, nous avons inventé la guerre. Aucune société ne s’est jamais complètement libérée de la violence, mais très peu en ont fait un mode de vie comme l’ont fait les sociétés civilisées.
Bibliographie
- Stephen Beckerman, Pamela I. Erickson, James Yost, Jhanira Regalado, Lilia Jaramillo, Corey Sparks, Moises Iromenga et Kathryn Long, « Histoires de vie, vengeance du sang et succès reproductif parmi les Waorani de l’Équateur », Actes de l’Académie nationale de Sciences 106 (2009) : 8134.
- Napoléon Chagnon, Yanomamo : Le Peuple Féroce . (Dumfries : Holt McDougal, 1968)
- Stephen Corry, « Why Steven Pinker, Like Jared Diamond, is Wrong », Truthout , 11 juin 2013.
- Taunya Dressler, « Vous avez besoin d’une personne », Continuum , printemps 2010.
- Gwynne Dyer, Guerre : la nouvelle édition . (Toronto : Random House of Canada, 2010)
- Brian Ferguson, Yanomami Warfare: A Political History (Santa Fe: School of American Research Press, 1995)
- Brian Ferguson, « La préhistoire de la guerre et de la paix en Europe et au Proche-Orient », dans Guerre, paix et nature humaine , éd. Douglas P. Fry (Oxford : Oxford University Press, 2013)
- Douglas Fry et Patrick Söderberg, « Agression mortelle dans les bandes de fourrageurs mobiles et implications pour les origines de la guerre », Science 341 (2013 : 270-273).
- McLean Gordon, « How Tribal Customs Confront Globalization Chaos », Motherboard , 29 septembre 2012.
- Jonathan Haas et Matthew Piscitelli, « La préhistoire de la guerre : induit en erreur par l’ethnographie », dans Guerre, paix et nature humaine , éd. Douglas P. Fry (Oxford : Oxford University Press, 2013)
- Michael Heckenberger, « Lost Garden Cities : Pre-Columbian Life in the Amazon », Scientific American , octobre 2009.
- Chris Hedges, « Ce que chaque personne devrait savoir sur la guerre », New York Times , 6 juillet 2003.
- Gustav Jahoda, Images de sauvages : racines anciennes des préjugés modernes dans la culture occidentale (Londres : Routledge, 1998)
- Allen Johnson, L’évolution des sociétés humaines : du groupe de recherche de nourriture à l’État agraire . (Redwood City : Stanford University Press, 2000)
- Lawrence Keeley, La guerre avant la civilisation . (Oxford : Oxford University Press, 1996)
- Raymond Kelly, Sociétés sans guerre et l’origine de la guerre (Ann Arbor : University of Michigan Press, 2000)
- Robert Kelly, The Lifeways of Hunter-Gatherers: The Foraging Spectrum , (Cambridge: Cambridge University Press, 2013)
- Hans Kelson, Société et nature : une enquête sociologique . (Clark : The Lawbook Exchange, Ltd., 2009)
- Bruce Knauft, « Réduction de la violence chez les Gebusi de Papouasie-Nouvelle-Guinée », dans Origins of Altruism and Cooperation , éd. Robert Sussman et C. Robert Cloninger (New York : printemps 2011)
- Margaret Mead, « La guerre n’est qu’une invention – pas une nécessité biologique », dans The Dolphin Reader (deuxième édition), éd. Douglas Hunt (Boston : Houghton Mifflin Company, 1990) : 415-421.
- Steven Pinker, Les meilleurs anges de notre nature : Pourquoi la violence a décliné (Londres : Penguin Books, 2011)
- Marshall Sahlins, « Jungle Fever », The Washington Post , 10 décembre 2000
- Daniel Steel, “Trade Goods and Jívaro Warfare: The Shuar 1850-1957, and the Achuar, 1940-1978,” Ethnohistory 46 (1999): 745-776.
- Paul Taçon & Christopher Chippindale, “Australia’s Ancient Warriors: Changing Depictions of Fighting in the Rock Art of Arnhem Land, NT,” Cambridge Archaeological Journal 4 (1994): 211.
- Elizabeth Thomas, The Old Way : A Story of the First People (New York : Sarah Crichton Books, 2006)
- Nancy Williams, Two Laws: Managing Disputes in a Contemporary Aboriginal Community (Canberra : Australian Institute of Aboriginal Studies, 1987)

Poster un Commentaire