
Voici un court extrait du livre La fin des terroirs d’Eugen Weber (Fayard, 1983), où nous pouvons comprendre que l’idée de civilisation repose sur une idéologie suprémaciste et raciste qui s’applique autant pour dénigrer les “primitifs” de quelque pays exotique, que les “sauvages” de notre propre nation, soit la classe paysanne, encore en contact avec la terre. En effet, il faut sortir ces hordes de gueux miséreux de leur mode de vie de subsistance, d’autosuffisance locale ! La civilisation, la ville, le Progrès, l’école, l’état, sont tout autant d’institutions / idéologies qui œuvrent à éloigner l’être humain de tout ce qui se rattache à la nature afin de le rattacher à la société marchande.

De Bordeaux à Bayonne s’étendaient des solitudes incultes. On en trouvait de même de l’île d’Yeu jusqu’à la Drôme, dans l’Est, où, en 1857, un colonel exprimait l’espoir que le chemin de fer améliorerait le sort « de populations en retard de deux ou trois siècles sur leurs contemporains » et éliminerait « les instincts sauvages nés de l’isolement et de la misère ». Les habitants de Tulle appelaient les paysans peccata (péchés), et un prêtre de la Corrèze, fils d’une humble famille de cette préfecture, mais relégué dans une paroisse de campagne, notait avec mépris : « Le paysan c’est bien le péché, le péché originel, encore persistant et visible dans toute sa naïveté brute. » Cette observation, relevée par Joseph Roux, a probablement été faite au début de la Troisième République, mais elle reflète un consensus qui eut cours pendant les premiers trois quarts du siècle. « L’habitant de la campagne porte dans tous ses traits l’aspect de la tristesse et de la souffrance ; son regard est incertain, timide, sa physionomie sans expression, son allure lente et embarrassée, ses longs cheveux qui tombent sur ses épaules lui donnent, quelque chose de sombre » (Haute-Vienne, 1822). Terrible ignorance, superstition, saleté (Morbihan, 1822). Être paresseux, cupide, avare, méfiant (Landes, 1843). Crasse, habits loqueteux, misère et sauvagerie (Loire-Inférieure, 1850). « Vulgaire, à peine civilisé, avec une nature humble, mais brutale » (Loire, 1862). Il n’est pas étonnant qu’en 1865, une propriétaire terrienne limousine employât des termes assez semblables à ceux utilisés par La Bruyère deux cents ans auparavant : « Ces animaux à deux pieds qui ressemblent à peine à des hommes. Ses vêtements [du paysan] sont sordides ; sous sa peau épaisse et tannée on ne voit pas le sang circuler. Le regard sauvage et morne ne trahit pas le mouvement d’une idée dans le cerveau de cet être, atrophié moralement et physiquement. »
Les soulèvements populaires de décembre 1851 apportèrent leur lot de commentaires : horde sauvage, pays de sauvages, de barbares. Il ne faut pas oublier que traiter abusivement quelqu’un de sauvage était considéré comme un outrage passible d’amende ou même de prison, si l’affaire allait jusqu’aux tribunaux. Mais la litanie se poursuit : au début des années 60, la sauvagerie a disparu de la Nièvre, mais subsiste jusqu’à la décennie suivante dans la Sarthe, où les « sauvages » habitants des landes vivent comme des « troglodytes » et dorment près du feu dans leurs huttes « sur des bottes de bruyère comme des chats sur des copeaux ». Elle persiste également en Bretagne, où les enfants qui rentrent à l’école « sont comme ceux des pays où la civilisation n’a pas pénétré : sauvages, sales, ne comprenant pas un mot de la langue » (1880). Un spécialiste de folklore musical, parcourant le pays de l’ouest de la Vendée jusqu’aux Pyrénées, compare la population locale à des enfants et des sauvages qui, heureusement, comme tous les peuples primitifs, montrent un goût prononcé du rythme. Même en 1903, le thème de la « sauvagerie » rurale est encore repris par un auteur de récits de voyages : visitant le Limousin, au nord de Brive, il est frappé par l’aspect inhospitalier de la région et par les huttes de sauvages dans lesquelles vivent les gens. Quel soulagement, après la traversée des interminables châtaigneraies, d’atteindre une agglomération, même petite. La civilisation est urbaine (civile, civique, bourgeoise, civilisée), et il en va de même, naturellement, de l’urbanité : de même que politesse, politique, police viennent de polis : toujours la cité.
La civilisation : voilà ce qui manque aux paysans. […] Dans les années 1850, en fait, il est courant de souligner ce point. Un prêtre de Beauce estime que le plus grand besoin de ses paroissiens est de devenir civilisés. En Haute-Loire, les bateliers de l’Allier montrent « le degré de civilisation le plus élevé », grâce aux « nations plus civilisées » qu’ils rencontrent sur le chemin de Paris. Il en va de même pour les gens de Saint-Didier, lieu où les relations commerciales avec Saint-Étienne ont contribué à une « civilisation plus avancée ». Dans le Morvan, par contre, un guide de 1857 note que les villages sont « à peine effleurés par la civilisation » ; des comptes rendus militaires révèlent la même situation dans le Lot et dans l’Aveyron.
Entre 1860 et 1880, nous trouvons sans cesse des références, dans les rapports des inspecteurs des écoles primaires, au progrès de la civilisation et au rôle civilisateur des écoles dans les populations auprès desquelles elles sont implantées. Que signifiaient ces rapports pour les contemporains ? Nous examinerons cette question en détail le moment venu. Disons pour l’instant qu’ils reflétaient la croyance prédominante que des zones et des groupes de population importants étaient encore non civilisés, c’est-à-dire non intégrés, non assimilés à la civilisation française : ces populations étaient pauvres, arriérées, ignorantes, sauvages, barbares, incultes, et vivaient comme des bêtes avec leurs bêtes. Il fallait leur enseigner les manières, la morale, l’alphabet, leur donner une connaissance du français et de la France, une perception des structures juridiques et institutionnelles existant au-delà de leurs communautés immédiates. Léon Gambetta résume la chose en quelques mots en 1871 : les paysans sont « intellectuellement en retard de quelques siècles sur la partie éclairée du pays » ; « la distance est énorme entre eux et nous…, nous qui parlons notre langue, tandis que, chose cruelle à dire, tant de nos compatriotes ne font encore que la balbutier » ; la propriété matérielle doit « devenir l’outil de leur progrès moral », c’est-à-dire de leur civilisation. Le paysan doit être intégré dans la société, l’économie et la culture nationales : la culture de la cité et de la Cité par excellence, Paris.

C’est là le sens de la campagne qu’indiquent les rapports sur le progrès : dans le Morbihan des années 1880, la civilisation doit encore pénétrer les sauvages contrées de l’intérieur et les rendre semblables au reste de la France ; mais en Ardèche, « des coutumes plus douces et plus policées remplacent les manières rudes, grossières et sauvages ». À l’Ouest, sur la côte Atlantique, les anciennes coutumes sont « balayées par la civilisation ». Jusqu’au succès final de cette campagne, le paysan continuera à être, selon les termes de deux observateurs du Sud-Ouest, une ébauche grossière et incomplète de l’homme réellement civilisé.
Une ébauche incomplète, si on la compare à un modèle auquel il ne se conforme pas, et pour une excellente raison : il ne le connaît pas. D’un point de vue culturel et politique, c’est un aborigène, un primitif semblable aux bêtes et aux enfants, un être que les observateurs les plus bienveillants trouvent décidément bizarre. En 1830, Stendhal parle de ce triangle mortel situé entre Bordeaux, Bayonne et Valence : « On croit aux sorciers, on ne sait pas lire et on ne parle pas Français en ces pays. » Et Flaubert, se promenant dans une foire de Rosporden en 1846, tel un touriste visitant quelque bazar exotique, note à propos du paysan : « Soupçonneux, inquiet, ahuri par tout ce qu’il voit et ne comprend pas, il se hâte de quitter la ville. »
Eugen Weber

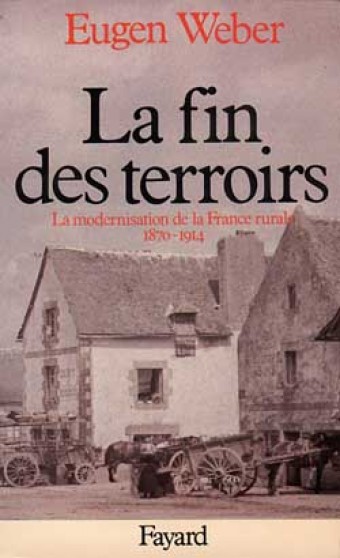
Poster un Commentaire